
Lucie Domenach
-
Diplôme de 1er cycle danse contemporaine 2020Danse contemporaine
S'en sortir sans sortir
- Pensée première, février 2020 : « Je veux travailler sur une forme d’acceptation, en rapport avec le présent. Et je vois bien une bonne, énorme salade de fruits. »
- Pensées secondes :
« Longer des formes et former légèrement, des lignes parfaites et des carrés tranchants. »
« Les sens de la vie »
« Écrire un texte. »
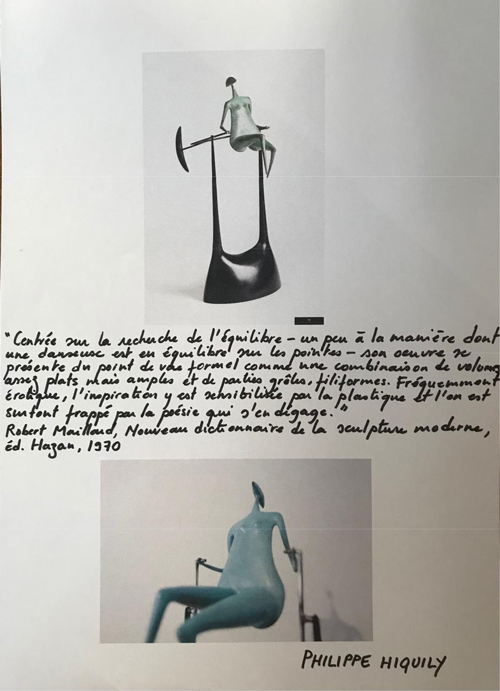
Que représente pour vous la danse contemporaine en 2020 ?
À mes yeux, la danse contemporaine en 2020 relève d’un héritage précieux qui va dans le sens de l’ouverture sur son temps qu’il faut conserver et entretenir. Au sens étymologique du terme, « contemporain » implique de vivre avec son temps. Vivre avec son temps en 2020 ne m’a jamais paru si réel. En 2020, la danse contemporaine représente un vrai changement, une renaissance. Pour une étudiante comme moi, qui n’a jamais connu que des conditions de travail exceptionnelles pour évoluer dans ma danse, le confinement a tout bousculé. Le confinement est un mot cotonneux et presque rassurant qui m’apparaît comme l’effet d’une lame tranchante. Cet « enfermement » est pour moi très concret, très palpable et implique une nouvelle approche sur ma danse et sur la création.
Pour parler de mon approche sur la danse contemporaine en 2020, j’ai envie de reprendre les termes de Rudolf Laban. Je vais parler du corps, de l’espace, de l’effort et de la forme que prend ma danse, pour retracer la nouvelle approche dont je parle.
En 2020, qu’est ce qui bouge dans le corps et comment ça bouge ? Mon corps se structure autrement, je trouve une nouvelle organisation, le mouvement, physiquement part d’endroits déjà explorés, mais est inspiré par de nouveaux éléments. J’ai l’impression que c’est une remise en question permanente. Il ne s’agit plus de bouger selon un surplus d’informations, de ressources mises à dispositions, de professeurs expérimentés omniprésents. C’est un retour à « l’état de nature », dans lequel chacun doit nécessairement apprendre à s’écouter plus profondément, trouver la seule source de vérité : la sienne, pour un résultat dans le corps qui donnera tout son sens.
En 2020, dans quel espace s’inscrit le mouvement ? Il s’agit de vivre en harmonie avec son environnement, d’apprendre à y évoluer sans peine. Très facile à écrire, moins facile à concrétiser. Mettre une bâche dans l’herbe, danser dans le maquis, sur du carrelage, sur une terrasse ou dans une chambre… Finalement, c’est une réelle question d’adaptation, et surtout de volonté. L’espace est sans doute pour moi le facteur le plus déterminant dans ma vision de la danse contemporaine en 2020. C’est savoir tirer profit de chaque lieu, de chaque endroit, voir l’espace comme une possibilité de danser quoi qu’il en soit. Et comment ne pas se perdre dans l’espace, même le plus restreint. Comme l’a dit Léonard de Vinci : « Un corps en mouvement acquiert dans l’espace autant de place qu’il en perd. » C’est une prise de conscience que le studio ne peut pas aussi bien m’apprendre à maîtriser. Je vois la danse contemporaine comme une vision neuve sur l’utilisation et la rentabilisation de l’espace autour de soi.
En 2020 comment s’exécute le mouvement et quel est l’effort nécessaire ? C’est là que je m’intéresse à la diversité des combinaisons corporelles possibles relatives aux quatre facteurs que sont le poids, l’espace, le temps et le flux. C’est le moment où je me pose la question de la visualisation du contexte de réalisation. Je me sens bipolaire dans ma tolérance, mon acceptation et mon adaptation à la vie de tous les jours en 2020. Je viens d’ailleurs d’utiliser un rythme ternaire pour parler d’un état de dualité, comme pour alléger le tout. Je sens que le mouvement est fugace et tranchant. Je vois la danse contemporaine sous un jour où il ne faut plus chercher à remplir des cases, des critères, respecter des échéances. Dans « l’effort » physique et mental que demande la danse, j’ai de plus en plus la conviction qu’il faut laisser du temps au temps et ne pas chercher à surproduire. Dans le but d’une création artistique pertinente et édifiante quel qu’en soit l’enjeu, le processus d’élaboration nécessite des évidences. Des évidences en ce sens que tout ne se provoque pas selon moi dans la danse, que l’intellectualisation des sensations ne suffit pas à les trouver et à les interpréter. D’après Béjart, « la danse, un minimum d’explications, un minimum d’anecdotes, et un maximum de sensations ». Ainsi, je vois la danse contemporaine prendre un chemin vers une sobriété plus heureuse. La route de la modération relative à la qualité d’une force de proposition.
Enfin, la forme. Quels sont les chemins empruntés ? La plastique du corps dansant change à chaque instant. La forme est importante, car c’est ce qui est perçu par les autres, c’est un réel moyen de communication signifiant. Je me questionne sur le but de donner une forme, sur l’expression même « donner une forme », sur le sens de « donner ». À donné-je ? Est-ce que ce qui est important, c’est de donner une forme à ce que je pense, à ce que je suis et donc me donner, dans le sens de recevoir, moi, une forme ? Comme une manière de me façonner ? Où est-ce que l’important c’est de donner, dans le sens d’offrir, une forme au regard extérieur pour légitimer ce que je fais, ce que je suis. La danse contemporaine en 2020, c’est savoir se reconnaître en tant qu’émetteur et déterminer son récepteur. Faire la différence. C’est aussi accepter les répercussions de la visée « recevoir » et de la visée « offrir » quand notre mouvement prend forme.
La danse contemporaine en 2020 représente ainsi pour moi la porte d’entrée vers une plus grande conscience. L’ouverture sur la danse vraie et volontaire, intimement.
Qu'est-ce qui vous tient particulièrement à cœur dans votre engagement de danseur ?
Dans mon engagement de danseuse, j’ai foi en deux dévouements : un engagement personnel, et un engagement plus philanthrope.
Pour évoquer mon engagement personnel, il s’agit d’aller toujours plus loin. Je n’ai trouvé aucun mot qui me plaise pour simplifier cette expression. J’ai cherché plus jeune, dans mon parcours scolaire, dans mes activités sportives, dans mon rapport aux autres et à moi-même le moyen d’aller toujours plus loin. J’ai cherché et je cherche encore la limite. De manière un peu légère, je dirais que je suis intimement liée depuis longtemps à la compétition, la compétition avec moi même. Je travaille sérieusement depuis une blessure importante, à rendre ce perpétuel défi constructif et sain. Je n’ai jamais trouvé ailleurs la même sensation qu’en dansant, celle qui te laisse toujours dans cette insatisfaction grisante. Je me dis que je peux toujours aller plus loin, toujours danser plus, ou danser autrement. Il n’y a jamais un état, une gestuelle, une idée qui me laisse penser que je l’ai développée suffisamment et que je peux enfin passer à autre chose. Si je passe à autre chose, c’est uniquement par choix, dans le but de passer à autre chose. C’est dans l’épuisement du traitement d’un sujet que j’y trouve mon compte, que je trouve enfin la pente ascendante. Et une fois que j’ai approfondi, je choisis de passer à autre chose, car on ne cesse jamais de pouvoir approfondir. Cet engagement relève de la volonté de m’épanouir, de me comprendre. Je cherche un moyen de me parler, un lieu de paix, un défouloir, un laboratoire de recherche. Mon engagement personnel en tant que danseuse, c’est cultiver mon jardin.
La danse comme ouverture sur le monde. C’est mon engagement second, ouvert. Par la danse, je fais chaque jour vœu de construction de moi même pour ensuite être capable de me déconstruire. En me connaissant bien moi-même, je pourrai ensuite arriver à comprendre les autres, cerner une demande, capter une envie, un état, une émotion et l’interpréter. Danser ce que je pense, par opposition à dire ce que je pense, car « la danse n’a plus rien à raconter : elle a beaucoup à dire ». C’est développer la danse comme moyen de communication qui me tient à cœur. J’ai souvent du mal à trouver le mot juste, la bonne étiquette pour m’expliquer, je trouve la plupart du temps que mon ressenti est ineffable. En tournant le dos à la parole, j’ai la certitude via le mouvement, la danse, de m’ouvrir plus largement aux autres et à moi même.
La danse est d’ailleurs « l’une des formes les plus parfaites de communication avec l’intelligence infinie », comme le souligne Paulo Coelho, artiste et romancier. C’est en fait un engagement de vie. Servir des causes, des idées auxquelles je crois, poser ma pierre sur le cairn, appartenir à quelque chose. C’est de la médiation culturelle d’autonomie, d’indépendance, une école de bien-être qui passe par la contrainte, les limites, la frustration. C’est une école de savoir-être, de savoir-vivre. Cela me tient à cœur de faire savoir la danse, la vraie, la danse volontaire, intimement, de faire traverser la danse et de la faire adhérer. De lui rendre sa légitime importance à tous ses égards.
Que retirez-vous des 4 années au CNSMDP ?
Cette dernière question arrive au bon moment. J’ai passé cinq ans au CNSMDP et j’ai pris le temps de me délecter de chaque moment vécu. Je vais parler de ce que je retire de ces cinq années dans l’ordre chronologique des événements.
Je retiens pour commencer, le plongeon de l’enfance vers l’âge adulte. Ce plongeon se caractérise pour moi par la prise de décisions difficiles, faire des choix importants. Encore mineure, j’ai pris la décision seule d’intégrer cette école, une décision qui, à bien des égards, n’a pas été facile à prendre. Puis le choix entre mes études à Dauphine et la danse au Conservatoire. Ces deux fois, le choix s’est présenté à moi comme une évidence. Une évidence inconsciente et légère, comme si je n’étais que partiellement volontaire. Deux semaines plus tard, je me déchire les ligaments croisés en dansant. Après l’opération, au moment où marcher n’était pas en option, le choix est revenu. Un choix bien plus large encore : des études ? quelles études ? partir ? rester ?
À titre personnel, j’ai vécu six mois très difficiles. C’est de là que je retire un autre aspect du CNSMDP : la désillusion, l’échec, la déception. Complètement livrée à mes démons du moment, j’ai disparu de l’école qui me servait aussi de maison et je ne manquais à personne, je n’inquiétais personne, personne n’avait besoin de moi, même la danse en tant qu’entité m’ignorait.
C’est là que je retire de cette école la détermination, la volonté, l’exigence et la notion d’individualité au sein du groupe. Plus indirectement, comment évoluer au sein d’un groupe. Mon impatience faisait alors souvent défaut à mon acceptation de la différence. J’ai appris à comprendre que nous ne fonctionnions pas tous de la même manière. J’ai appris à discerner les danseurs intellectuels des danseurs instinctifs, les danseurs offensifs, les danseurs à l’écoute très sensible, j’ai appris à être force de proposition, à atténuer des tensions, trouver des consensus, développer ma singularité, me faire confiance et surtout, faire confiance. J’ai cherché à aller toujours plus loin, à répondre à des attentes élevées, et j’ai ainsi, à la suite de cette blessure, construit sérieusement mon premier engagement personnel. Celui qui consiste à repousser mes limites, développer ma curiosité, danser comme si personne ne me regardait, cultiver mon jardin.
Bien sûr, je retire un enseignement, je dirai même, une éducation. Particulièrement motivée par la contrainte et la provocation (bienveillante, peut être est-il nécessaire de préciser), je voue à l’égard de certains professeurs une grande reconnaissance. J’ai été élevée dans cette structure par des femmes fortes, qui maîtrisent tout, même le laisser-aller. J’ai été façonnée par des hommes uniques avec des parcours d’excellence rares. Je retiens leur chemin, je retiens leur dévouement, leur générosité et le don de soi, l’attachement qu’ils ont pu avoir parfois, même sans que cela me concerne moi particulièrement. Directement lié à cela, je retire les opportunités de stages à l’étranger, de scènes, de master classes, de projets en extérieur. Quelle chance d’avoir dansé au Zénith de Paris pour le Grand bal Modern Style, ou au Grand Palais pour une approche nouvelle et directe au public. Quelle chance d’avoir pu prolonger ce genre d’expérience immersive avec Philippe Découflé au Théâtre national de Chaillot et d’avoir dansé sur la scène de la Grande halle de La Villette pour le centenaire de Merce Cunningham. Bien plus que de la chance, j’en retire du travail, de la rigueur, de l’expérience et de la professionnalisation.
De manière tout à fait corrélée, je retiens également une vraie relation au stress et à la pression. Comment apprendre à gérer mes émotions, doser mon énergie, maintenir l’adrénaline pour décupler mes possibilités, me laisser aller, lâcher prise… Lâcher prise, surtout, j’y travaille.
Pour finir, et c’est surement le plus important, je retire de ces quatre années au CNSMDP de l’envie. J’ai trouvé ma voie : je veux continuer à m’épanouir dans le monde artistique, continuer à faire ce que j’aime, avec toutes les difficultés que cela implique. Pareillement à Nelson Mandela – et je pèse cette dernière citation : « C’est la musique et la danse qui me mettent en paix avec le monde. »
